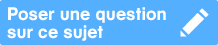Qu’est-ce que le bioéthanol ?
Le bioéthanol est un biocarburant produit, à partir de céréales (blé, maïs...) ou de betteraves et de cannes à sucre, et destiné aux moteurs essence....
Le bioéthanol est un biocarburant produit, à partir de céréales (blé, maïs...) ou de betteraves et de cannes à sucre, et destiné aux moteurs essence. Le bioéthanol est le biocarburant le plus utilisé au monde. En France, l’objectif est d’incorporer 10% de bioéthanol à la consommation de carburants en 2020, ce qui correspond à moins de 3% des surfaces françaises cultivées en betteraves et en céréales et moins de 1% de la Surface Agricole Utile totale française : il n’y a donc aucune concurrence alimentaire liée à la production de bioéthanol en France.
A part le sucre, quels sont les autres produits provenant d’une sucrerie ?
Le sucre n’est pas le seul produit qui sort de la sucrerie : on appelle co-produit du sucre une matière créée au cours du même processus de...
Le sucre n’est pas le seul produit qui sort de la sucrerie : on appelle co-produit du sucre une matière créée au cours du même processus de fabrication que le sucre et en même temps. On emploie préférentiellement le terme « co-produit » plutôt que « dérivé du sucre ».
Lorsque les cannes ont été pressées pour en extraire le jus sucré, il reste un produit pulvérulent riche en fibre, la bagasse, qui sert de combustible pour alimenter la sucrerie en énergie. Les betteraves, une fois épuisées en sucre par diffusion dans l'eau chaude, prennent le nom de pulpes, utilisées en alimentation animale. Pour la sucrerie de canne ou de betterave, le produit final non cristallisé, visqueux et très coloré, est la mélasse ; on l'utilise comme support de fermentation pour la production d'alcool, de levures ou de micronutriments. Dans certains pays, la mélasse de canne est consommée pour apporter des arômes et réhausser la saveur de certains desserts.
Des alcools agricoles sont obtenus par fermentation des jus extraits des plantes sucrières puis d'éventuelles distillations successives (utilisations en consommation humaine, ménagère et chimique).
Le bioéthanol (biocarburant) est obtenu à partir de la fermentation du sucre en alcool (éthanol).
Enfin, on obtient également des écumes utilisées comme amendements agricoles pour leur richesse en calcium.
Ainsi, la bagasse, les pulpes, la mélasse, les alcools agricoles, le bioéthanol ainsi que les écumes sont des co-produits du sucre.
Pour en savoir plus sur les co-produits
Voir l'infographie sur les co-produits en sucrerie

Où sont principalement situées les sucreries en France ?
Les 25 sucreries de France métropolitaine sont principalement implantées au Nord de la Loire, dans les zones de culture betteravière, entre le Loiret...
Les 25 sucreries de France métropolitaine sont principalement implantées au Nord de la Loire, dans les zones de culture betteravière, entre le Loiret et le Pas-de-Calais. Il existe toutefois deux exceptions dans cette géographie sucrière : la sucrerie de Bourdon dans le Puy de Dôme et celle de Erstein dans le Bas-Rhin. Il existe également une raffinerie, située dans le port de Marseille.
Quelle est la durée d’une campagne sucrière ?
La betterave sucrière est une plante bisannuelle, c’est-à-dire qu’elle accomplit son cycle en deux années. La première année correspond à la phase...
La betterave sucrière est une plante bisannuelle, c’est-à-dire qu’elle accomplit son cycle en deux années. La première année correspond à la phase végétative de la plante où elle se développe et accumule ses réserves en sucre au niveau de la racine. Lors de la deuxième année, la plante entre dans une phase reproductive où elle porte des fruits contenant les graines. Pour extraire le maximum de sucre, on récolte la betterave en automne, dès la fin de la première année. En France métropolitaine, la campagne sucrière dure entre 70 et 100 jours. Quant à la canne à sucre, le cycle de culture est d’environ 10 à 12 mois. La durée de la campagne sucrière est très variable selon les pays : elle s’effectue de février à juin aux Antilles et de septembre à novembre à la Réunion.
Y-a-t-il une différence entre une sucrerie de Betterave et une sucrerie de Canne ?
Si l'arrachage des betteraves est aujourd’hui effectué mécaniquement, la récolte de la canne à sucre a encore lieu manuellement dans de nombreux...
Si l'arrachage des betteraves est aujourd’hui effectué mécaniquement, la récolte de la canne à sucre a encore lieu manuellement dans de nombreux pays. La canne est coupée au ras du sol, le haut de la tige est sectionné, et les feuilles arrachées ou brûlées avant la coupe. La tige de la canne présente un taux de fibres trois fois supérieur à celui de la racine de la betterave, avec une proportion importante de lignine, ce qui rend son extraction par broyage possible. Elles subissent un découpage dans des «coupe-cannes» et sont débitées en morceaux très courts, lesquels sont ensuite entraînés dans un défibreur, puis éventuellement dans un broyeur nommé «shredder» qui achève de les réduire en fines particules. Les racines de betterave sont quant à elles découpées et râpées en « cossettes » puis plongées dans l’eau chaude. La technique d’extraction du sucre de betterave se fait par diffusion à contre-courant. Le procédé utilisé pour la canne repose sur le principe de "pression - imbibition" : les cannes passent dans une série de moulins (4 à 6 moulins successifs) qui les écrasent et en extraient le jus. Après extraction du jus sucré, les fibres de canne, constituent la "bagasse", qui sert de combustible à la sucrerie. Les cossettes épuisées en sucre prennent le nom de pulpes, elles sont pressées et séchées, avant d’être utilisées pour l’alimentation animale. Les impuretés ou « non-sucres » contenus dans les jus sucrés extraits de la canne sont différentes de celles de la betterave : on trouve davantage de précurseurs de colorants dans le jus de canne (fructose, glucose, composés phénoliques), les jus sucrés de betterave contenant plus de matières protéiques et minérales. Le procédé pour éliminer les impuretés (épuration) repose sur l’utilisation de la chaux (chaulage), qui adsorbe, dégrade et entraîne ces « non-sucres » par précipitation. En sucrerie de betterave, on complète le chaulage par l’addition de gaz carbonique (carbonatation) qui accélère la précipitation des impuretés et favorise leur filtration. Le jus sucré extrait de la canne est chaulé, mais ne subit pas de carbonatation. En revanche, le jus passe par un décanteur qui isole "les boues" et les évacue par un système de pompes. Après l’étape d’épuration, les jus sucrés de canne ou de betterave sortent clarifiés et limpides. Ils seront ensuite traités de manière identique : concentration par évaporation, cristallisation en trois cycles de cuisson (appelés jets) et séchage avant stockage ou conditionnement. Actuellement, les sucreries de betterave produisent quasi-exclusivement du sucre blanc, issu directement du premier cycle de cristallisation. Le chauffage prolongé durant les cycles suivants provoquent la formation de composés colorés de type caramel. On obtient alors des sucres roux qui sont, pour une petite partie, commercialisés sous le nom de « vergeoise ». En raison de la présence de précurseurs de coloration, le sucre de canne de premier jet (premier cycle de cristallisation) est déjà coloré. Commercialisé en l’état, ce sucre roux prend le nom de « cassonade ». Mais l’essentiel de la production de sucre roux est acheminé vers des raffineries qui vont éliminer les impuretés (sels minéraux, matières colorantes,…) et produire du sucre blanc.

Y-a-t-il une différence entre une sucrerie et une raffinerie ?
Oui. Dans une sucrerie, il entre des betteraves sucrières ou de la canne à sucre ; on y extrait le sucre qu'elles contiennent en le cristallisant. Il...
Oui. Dans une sucrerie, il entre des betteraves sucrières ou de la canne à sucre ; on y extrait le sucre qu'elles contiennent en le cristallisant. Il sort du sucre blanc et / ou du sucre roux. Dans une raffinerie, il n'entre pas de plantes sucrières mais seulement du sucre roux, qui est refondu, débarrassé de ses impuretés colorées et recristallisé. Il en sort donc principalement du sucre blanc. A noter que les raffineries ont souvent une activité complémentaire de conditionnement du sucre roux qu'elles reçoivent ainsi que du sucre blanc qu'elles produisent.